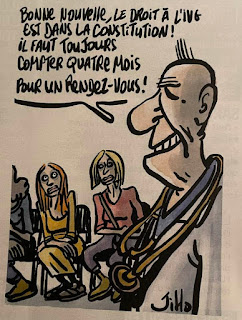A quelques jours du retour à l’école
pour un grand nombre d’élèves, quoi de mieux que de se pencher sur le sujet
polémique de ces dernières semaines : l’instauration de groupes de niveaux
en français et en maths pour les classes de 6ème et 5ème à
la rentrée 2024.
Cette question soulève un vaste rejet de la part de la
communauté éducative, entre autres pour des aspects de moyens humains et
logistiques. Indéniablement cela va poser de véritables problèmes dans les
collèges, y compris en termes d’emploi du temps. Mais ce ne sont pas ces aspects,
aussi importants et légitimes soient-ils, qui m’intéressent. En réalité, c’est
davantage la « mécanique intellectuelle, la philosophie » qu’il
y a derrière la mesure annoncée en décembre par Gabriel Attal, alors ministre
de l’Éducation nationale, qui m’a poussé à m’interroger.
Pour résumer en quelques mots l’argumentaire des opposants
à ce dispositif, l’idée est de dire que celui-ci va imposer une ségrégation
institutionnalisée des collégiens et va conduire à stigmatiser les élèves en
difficultés en leur apposant une étiquette dès le début de l’année. Et tout
cela en amplifiant les inégalités au lieu de les réduire ce qui était l’objectif
initial. Preuve en serait qu’un certain nombre d’études iraient en ce sens.
Cela étant posé, sommes-nous bien plus avancés ? Pas totalement
à vrai dire. Sauf à considérer que l’argument d’autorité des études sur le
sujet met un point final au débat. Trop simpliste à mon sens et ce d’autant
plus où d’autres études sont davantage mesurées dans leurs conclusions
indiquant que ces groupes permettent notamment aux plus forts de progresser plus
encore que s’ils étaient dans une classe multiniveaux.
Mais peut-être avons-nous mis là le doigt sur un aspect qui
fâche. Des élèves déjà bons dans un domaine continueraient à progresser,
creusant ainsi l’écart avec leurs camarades. Quelle hérésie pour les défenseurs
d’un égalitarisme à toute épreuve ! Faudrait-il alors brider ces enfants
là pour ne pas heurter ceux qui sont le plus en difficulté ? Belle
opération de nivellement par le bas …
Mais laissons un peu de côté l’ironie pour poser quelques constats
qui, s’ils peuvent déplaire, n’en sont pas moins une réalité. Même si l’on souhaiterait
le contraire, les élèves ne sont pas tous égaux et ne disposent pas tous des
mêmes capacités, que cela s’explique par leur situation familiale, culturelle, économique
ou même pour des raisons propres à l’individu. Indéniablement, certains enfants
sont favorisés par rapport à d’autres et verront leurs possibilités accrues du
fait de ce contexte.
Partant de cet état de fait, le rôle de l’école ne doit-il
pas être de chercher justement à réduire cette inégalité des chances ? Et
donc d’œuvrer à donner les moyens à chacun d’acquérir les savoirs, savoir-faire
et savoir-être qui lui permettront de s’accomplir ? Poser la question c’est
finalement y répondre. Et si j’en suis convaincu je crois pourtant que,
malheureusement, notre système éducatif peine à réaliser cet objectif.
Pointer du doigt l’ensemble des maux de l’Éducation Nationale
serait bien trop long et serait d’ailleurs hors sujet par rapport au sujet qui
nous occupe. Pour autant, profitons de l’occasion pour préciser que la question
des moyens et par conséquence la problématique des effectifs est une difficulté
majeure de notre système. Comment imaginer que nos enfants apprennent et
progressent dans des classes surchargées à 30 élèves voire plus parfois.
Impossible alors d’espérer un quelconque accompagnement individuel de qualité.
Mais alors est-ce que des groupes de niveaux serait la
solution à tout ? Clairement non. Et si c’était le cas, cela aurait été
mis en place depuis belle lurette. Malgré tout cela pourrait faciliter les
choses par moment.
Si j’ai évidemment été élève il y a de cela quelques années
(voire un peu plus), j’ai également eu la chance de donner des cours de comptabilité-gestion
pendant une dizaine d’années à l’université et en école de commerce. L’idée n’est
pas de tirer des vérités immuables de cette expérience dans l’enseignement
supérieur car la population n’est pas la même qu’en école ou au collège. Pour
autant, les problématiques rencontrées en termes d’animation de classe peuvent,
pour certaines, converger.
En en particulier la notion d’effectifs intervient au
premier chef d’où la nécessité absolue de plafonner les classes à 20-25 élèves
voire moins si cela est possible. Et cela s’avère d’autant plus indispensable
dans le cas de classes hétérogènes avec d’importantes disparités de niveaux.
Sur ce dernier point d’ailleurs, je considère que pour un enseignant le fait d’avoir
des élèves avec des écarts de niveaux significatifs constitue un obstacle
supplémentaire au bon accomplissement de sa mission. De fait, cela conduit
inévitablement à tenir un cap commun frustrant à la fois les meilleurs qui seront
ralentis et les plus faibles qui se sentiront à la traine. Bref, un double
effet kiss cool négatif.
A l’inverse, un regroupement des élèves de manière plus
homogène permettrait d’avoir un rythme plus adapté aux besoins. Alors oui il
est probable que certains groupes aillent plus vite et plus loin que d’autres. Oui
certains groupes seront plus faibles que d’autres. Et alors ? N’est-ce pas
d’ailleurs déjà le cas dans le système actuel avec une tête de classe et
un peloton de queue que chaque professeur identifie aisément ? En quoi donc ces
groupes de niveaux constitueraient une aberration s’ils permettaient que chacun
puisse progresser à son rythme par un accompagnement renforcé ?
Rejeter par principe les groupes de niveaux ne fera pas reculer
les écarts entre élèves. Et refuser de voir le problème ne le fera pas
subitement disparaitre. C’est au contraire en prenant ce problème à bras le
corps et en mettant en place des mesures ciblées sur ceux qui en ont le plus
besoin telles que du soutien scolaire gratuit que l’on pourra corriger le tir.